34 – La colonisation
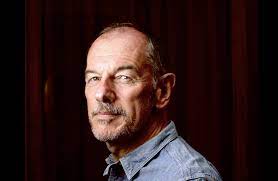
Nos ancêtres les gaulois et autres fadaises. L’histoire de France sans les clichés
34 – La colonisation
REPÈRES
– Règne de Charles X (1830) : prise d’Alger
– Monarchie de Juillet : conquête de Mayotte et Tahiti
– Second Empire : Nouvelle-Calédonie, Sénégal, Cochinchine et Cambodge
– Troisième République : Tunisie, Guinée, Haute Volta, Niger, Congo, Tchad, Madagascar, Indochine et Djibouti sous domination française
– 1919 : mandats français sur les anciennes possessions allemandes ou ottomanes (Syrie, Liban, Cameroun et Togo)
À la fin du XIXe siècle, nous disent les livres, lorsqu’un écolier français veut gonfler son cœur de gloire patriotique, il peut faire un geste simple : lever les yeux pour regarder la carte du monde qui orne la salle de classe et perdre son regard sur les immenses taches roses qui s’y étendent sur tous les continents. Afrique blanche, Afrique noire, Madagascar, Indochine, partout l’empire, partout la France, partout le drapeau ! Les livres nous disent moins à quoi peut bien songer alors, de son côté de la planète, l’enfant dont on vient d’obliger le peuple à vivre sous ce drapeau.
Nous allons parler d’un épisode de notre histoire finalement assez bref, mais qui l’a marquée durablement : la colonisation.
De fait, la pratique est ancienne. Il y eut, sous l’Ancien Régime, un « premier empire colonial français », c’est son appellation docte. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, dans la foulée des « Grandes Décou- vertes » et de la première mainmise de l’Europe sur le monde, ont été françaises une immense partie de l’Amérique du Nord (le Canada et la Louisiane) ; une partie de l’Inde ; quelques-unes des plus riches Antilles ; ou encore l’île de France – actuelle île Maurice. Tout, ou presque, a été perdu lors des guerres contre les Anglais sous Louis XV puis sous Napoléon.
Charles X, à la fin des années 1820, relance la machine d’une façon qui tient du vaudeville. Très impopulaire, il cherche à mener une petite guerre étrangère, moyen classique de reconquérir une opinion intérieure. Où la faire ? En 1827, de l’autre côté de la Méditerranée, le dey, patron de la « régence d’Alger », dépendance délabrée et lointaine du vieil Empire ottoman, offre un prétexte sur un plateau : exaspéré par une dette datant du Directoire que la France refusait toujours de rembourser, il donne un coup de chasse- mouches à notre consul. On n’est pas très sûr qu’il l’ait atteint et l’on sait bien par ailleurs que ledit consul est un escroc notoire, mais quand on cherche une guerre, on ne fait pas la fine bouche. Paris fait monter la sauce comme il se doit et trois ans plus tard, en juin 1830, 26 000 hommes débarquent à Sidi-Ferruch. En juillet ils prennent la capitale, mais c’est déjà trop tard : le roi à qui ils viennent d’offrir une victoire a perdu sa couronne. Ils se contentent donc de faire à son successeur ce cadeau assez encombrant auquel il tient fort peu : la métropole ne commencera à s’occuper de l’Algérie que dix ans plus tard. Mais, dès lors, le pli est pris : le « second empire colonial » est né, il ne cessera de croître.
Tous les régimes apporteront leur pierre à l’édifice. Sous la monarchie de Juillet, conquête de Mayotte et Tahiti. Au temps de Napoléon III, la Nouvelle-Calédonie, le Sénégal, et bientôt la Cochinchine et le Cambodge. Sous la IIIe République enfin, le mouvement prend une ampleur qui donne le vertige : en quelques décennies, la Tunisie, la Guinée, la Haute-Volta, le Niger, le Congo, le Tchad, Madagascar, l’Indochine tout entière, ou encore Djibouti passent sous domination française, et on en oublie forcément. Le Maroc, en 1912, est le dernier joyau posé sur cette couronne avant la Grande Guerre. Mais les traités qui y mettent fin en apportent d’autres, en rétrocédant aux vainqueurs les anciennes dépendances des vaincus : s’ajoutent ainsi à la liste une grande partie du Togo et du Cameroun, qui étaient allemands, ou la Syrie et le Liban, qui étaient ottomans. En 1931, porte de Vincennes, à Paris, des millions de visiteurs se pressent pour admirer les temples khmers et les villages indigènes, s’enivrer d’exotisme à deux sous, et se gaver d’une autocélébration qui, elle aussi, coule à flots. C’est la grande « Exposition coloniale ». Elle est considérée depuis comme l’apogée de l’empire. Au début des années 1960, après quinze ans d’une décolonisation plus ou moins douloureuse selon les endroits, il n’en reste rien, ou presque. On voit que cette fameuse colonisation dura peu. On sait aussi que son histoire continue à peser d’un tel poids sur la conscience collective de notre pays et de tous ceux qui en furent les victimes qu’il n’est pas inutile de tenter de la résumer en quelques idées claires.
Dans le détail, l’épopée est riche et complexe1. Les conquêtes se déroulent de façon très différente les unes des autres. Vers les années 1870-1880, l’explorateur Savorgnan de Brazza, un Français humaniste d’origine italienne qui a patiemment remonté le fleuve Congo et appris à connaître les populations, donne à la France un immense territoire sans avoir tiré un seul coup de fusil. Quelques années plus tard, au Dahomey (l’actuel Bénin) ou au Soudan (le futur « Soudan français », c’est-à-dire le Mali), il faut de longues guerres et beaucoup de canons pour soumettre les armées puis- santes du roi Béhanzin ou celles de l’empereur Samory, deux irréductibles guerriers qui resteront, pour cette raison, des héros dans la mémoire africaine.
Les régimes appliqués d’un bout à l’autre de l’empire sont divers. L’Algérie, après une longue « pacification » – c’est-à-dire une guerre impitoyable pour briser toute résistance à l’occupation et chasser de leur terre ceux qui y habitaient –, est devenue une colonie de peuplement, comme le sera la Nouvelle-Calédonie : la métropole y favorise l’implantation d’Européens. En Afrique noire ou en Indochine, les seuls Blancs qu’elle envoie sont les fonctionnaires qui administrent le pays, ou les industriels et commerçants qui y font leurs affaires. La Tunisie et le Maroc sont des protectorats : ils dépendent du ministère des Affaires étrangères, et la puissance coloniale y règle tout, comme ailleurs, mais elle y a maintenu une fiction de pouvoir national, un bey à Tunis, un sultan à Rabat. Après la guerre de 1914, s’ajoute un nouveau buisson à ce maquis administratif : les mandats, cette délégation de pouvoir octroyée par la Société des Nations (la SDN, ancêtre de l’ONU) pour administrer les possessions des vaincus.
L’épopée impériale
Les causes de ce grand mouvement historique sont tout aussi complexes. La politique y a joué son rôle. Dans les années 1880, les grands dirigeants républicains sont très favorables à l’expansion impériale, parce qu’ils pensent qu’elle peut redonner lustre et gloire au pays meurtri par la défaite de 1870. La propagande ne se fait pas prier pour aller dans ce sens : dans les grands journaux illustrés, dans les romans, la colonisation devient une épopée qui doit faire rêver les foules, avec ses grands héros, ses explorateurs et ses soldats partis civiliser les sauvages dans des jungles et savanes d’un exotisme fou. La droite, à ce moment-là au moins, y est hostile : ces chimères lointaines détournent la nation du seul but qui doit être le sien, reconquérir l’Alsace-Lorraine. « J’ai perdu deux sœurs, dit le leader nationaliste Déroulède, et vous m’offrez vingt domestiques. » Il les adoptera bien vite, comme tout son camp. En 1914, excepté ceux qui se situent à l’extrême gauche, tous les Français sont unanimement convaincus des grandeurs du colonialisme.
Ils ne sont pas les seuls. Cette fièvre a saisi toutes les nations d’Europe les unes après les autres. L’Angleterre, avec ses dominions – le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande –, avec les Indes, l’Afrique du Sud, l’Afrique de l’Est, l’Égypte et Malte, est la première puissance impériale au monde. Les Pays-Bas possèdent la gigantesque Indonésie ; le Portugal des comptoirs en Asie, le Mozambique, l’Angola ; l’Allemagne s’y met tard, mais prend pied au Cameroun, au Togo, au Tanganyika, au Rwanda, au Burundi. Du coup, l’Italie veut sa part, qu’elle aura bien du mal à prendre : partie à la conquête de l’Éthiopie, elle est défaite en 1896 à Adoua par les troupes du Négus. La date est restée célèbre, elle marque la première grande victoire d’une armée noire sur une armée blanche.
C’est le grand partage du monde. Il prend des tours surréalistes. L’historien néerlandais Henk Wesseling raconte l’obstination de Léopold II, le roi des Belges, à se mettre dans le mouvement. À tous les officiers de marine et les voyageurs qu’il croisait, il demandait : « Vous ne connaîtriez pas une île pour moi ? » Stanley, un mercenaire et aventurier gallois qu’il a pris à son compte, lui obtiendra le Congo, un pays quatre-vingts fois plus grand que sa Belgique. Il en fera dans un premier temps sa propriété personnelle. Son gouvernement, jugeant le gâteau démesuré, n’en voulait pas.
Souvent les rivalités se font rudes. En 1898, un convoi français dirigé par le capitaine Marchand essaie de traverser l’Afrique d’ouest en est et stationne à Fachoda, au Soudan. Arrive le général anglais Kitchener, qui estime que la zone est britannique. Il faudra bien du talent aux diplomates, à Paris et à Londres, pour éviter la guerre entre leurs deux pays. En règle générale, on s’en tire en organisant une sorte de troc entre les parts de butin. Il peut être négocié de puissance à puissance ou au cours de grandes conférences internationales (comme celle de Berlin en 1885, ou d’Algesiras en 1906). C’est le grand Monopoly des territoires. Je te laisse l’Égypte, tu me donnes le Maroc. Tu me laisses le Maroc, je te donne le Cameroun. Il va de soi qu’aucun des peuples concernés par le marchandage n’est convié au banquet : comment seraient-ils convives ? Ils sont au menu.
Des controverses infinies
La colonisation a été et reste un sujet passionnel. Les plaies ouvertes lors de cette période, ou lors des guerres qui y ont mis fin, sont toujours à vif, et les controverses qui en découlent infinies.
Quel est le bilan économique de cet épisode ? Pendant longtemps, il semblait entendu que les colonies étaient pour les métropoles un citron dont elles cherchaient à extraire tout le jus. À partir des années 1980, certains ont faite leur la thèse d’un historien de l’économie devenu célèbre, Jacques Marseille, qui prouvaient le contraire. En fait, la colonisation a coûté très cher à la France, notamment parce que, pour des raisons politiques, elle surpayait les biens coloniaux. Et après ?, pourrait-on rétorquer à notre tour. D’abord le prix fort ainsi payé servait sans aucun doute à enrichir les riches exploitants coloniaux, sûrement pas les populations elles-mêmes. Ensuite, cela ne résoud pas la question des dommages causés aux colonies par le bouleversement de leurs agricultures en monocultures – hévéa, cacao, café – dévolues uniquement à la satisfaction des besoins de la métropole. Enfin, si le système n’a même pas l’excuse de la cupidité, cela rend sa domination encore plus inacceptable.
N’oublions pas aussi, disent ses défenseurs, les infrastructures laissées par la présence française, et les bienfaits dont la métropole a gratifié les colonies. Il ne faut pas les nier, en effet, mais rappeler aussi combien ils furent limités. Il n’y a que dans les belles brochures de propagande que la France sème à foison, dans les lointaines savanes, les hôpitaux et les écoles. La réalité fut plus modeste et très contrastée. Dans les années 1930, à Madagascar, le taux de scolarisation des « indigènes », comme on disait, atteint presque 25 %. En Algérie, juste avant la guerre de 1914, après plus de quatre-vingts ans de domination française, il est de 2 %… Et si, dans de nombreux endroits, on construit, il faut savoir à quel prix ont été parfois payées ces constructions. Nul en Afrique n’a oublié le coût humain du chantier du chemin de fer Congo- Océan : conditions d’hygiène épouvantables, coups, chaleur et travail forcé ont joué à plein – 17 000 malheureux y ont laissé leur vie. « Un Noir par traverse », disait-on en exagérant un peu, mais pas tant.
Parmi ceux qui furent les agents de la colonisation, on trouve beaucoup de gens remarquables, d’administrateurs intègres, de médecins dévoués, de maîtres d’école sincèrement emplis de leur noble mission. Tous ne furent pas des brutes racistes, loin s’en faut. Nombreux le furent, ne les oublions pas non plus. « Moins le Blanc est intelligent, plus le Noir lui paraît bête », écrit André Gide dans le livre célèbre qu’il publie à son retour du Congo2. Dans ce récit de voyage, il dénonce les excès dont se rendaient coupables les pires vecteurs de l’exploitation : les sociétés concessionnaires, ces grandes compagnies privées à qui l’État avait délégué la gestion des ressources du pays, faute de pouvoir s’en occuper.
Le récit de Gide est moins isolé qu’on ne le croit, d’ailleurs. L’histoire coloniale est émaillée de scandales qui bouleversent la métropole, quand elle les apprend. Dès les premiers temps de la « pacification de l’Algérie », quelques généraux français, prétextant les horreurs dont se rendent coupables les Arabes, en inventent d’autres : par trois fois, durant l’été 1845, ils allument des feux devant les grottes où se sont réfugiés des villageois pour les asphyxier. La nouvelle des « enfumades » indigne Paris, provoque des incidents à la Chambre et, selon le très rigoureux Dictionnaire de la France coloniale, suscite des pétitions jusque dans les écoles.
En 1898-1899, deux officiers français, Voulet et Chanoine, à la tête d’un millier d’hommes, dirigent une « mission » au Tchad et, peut-être pris de folie, répandent terreur et barbarie partout où ils passent, massacrant des populations, brûlant les villages. Alerté, Paris finit par envoyer un colonel constater ce qui se passe. Il est abattu par les deux déments alors qu’il approche de la colonne. La presse s’empare de l’affaire, il est vrai que le scandale est énorme : détruire des villages, c’est une chose, mais tirer sur un officier français…
En 1903, en Oubangui-Chari (l’actuelle République centrafricaine), deux petits fonctionnaires coloniaux, cherchant un moyen, diront-ils, de « méduser les indigènes pour qu’ils se tiennent tranquilles », se saisissent de l’un d’entre eux et le font sauter vivant à la dynamite. Nous sommes le 14 juillet. La date était mal choisie. La nouvelle déclenche en France un tel tollé que le gouvernement décide de dépêcher sur place le vieux Brazza, celui-là même qui avait conquis la région vingt ans auparavant pour lui apporter les bienfaits du progrès. Il sera tellement atterré de ce qu’il y découvrira qu’il mourra sur le bateau du retour. L’étonnant est que rien de tout cela ne pousse quiconque à ce qui nous semble aujourd’hui évident : remettre en cause le système lui-même.
Une pure domination raciste
Car il est bien là, ce point têtu auquel on vient enfin. L’histoire coloniale était viciée dans son principe même : elle n’a jamais été autre chose que l’organisation d’une domination raciste. Nul ne s’en cachait, la chose avait été officialisée dès le départ par Jules Ferry, un de ses plus grands apôtres. Le 28 juillet 1885, dans le brouhaha d’un grand débat parlementaire sur les fondements de la politique coloniale, il en donne les tenants et les aboutissants : les « races supérieures ont des droits parce qu’elles ont des devoirs : le devoir de civiliser les races inférieures ».
Ce sentiment de supériorité n’est pas une spécificité française, tous les peuples européens pensaient la même chose au même moment, tous se vivaient comme les seuls « civilisés » quand le reste du monde était, par définition, peuplé de « sauvages ». Par ailleurs, la République prend soin d’habiller sa « mission civilisatrice » des plus nobles oripeaux. Toutes les conquêtes colo- niales, nous rappelle La République coloniale3, ont été initiées sous des prétextes humanitaires : il s’agit toujours de sauver des peuples d’affreux despotes ou de les arracher à des pratiques horribles. L’esclavage en est une. Deux mois après qu’il a obtenu la soumission de Madagascar, le général Gallieni le fait abolir et reçoit pour cela une magnifique médaille de la grande société antiesclavagiste de Paris. Quelques semaines plus tard, il introduit dans la Grande Île le « travail forcé » : l’organisation d’épouvantables corvées auxquelles sont soumis de force, et sans contrepartie de salaire, les « indigènes ». L’histoire se répétera partout. Partout, la République arrive avec la Déclaration des droits de l’homme en bandoulière, partout, elle se hâte bien vite de rappeler que, dans les faits, il faudra attendre pour les mettre en œuvre. Dans toutes les colonies règne à partir des années 1880 le « Code de l’indigénat », qui crée un statut particulier pour les habitants des pays soumis. Les colons sont des citoyens de plein droit, les gens qu’ils viennent dominer, non. Ils ne bénéficieront jamais d’aucune des libertés dont la France se proclame la championne, ni les droits politiques, ni le droit de réunion, ni les droits syndicaux : ils deviennent des parias dans leur propre pays.
Bien sûr, ce siècle n’est pas d’une pièce, l’histoire coloniale est émaillée des noms de grands réformateurs qui rêvèrent d’en changer le cours. Ils n’y arriveront jamais. Napoléon III n’est guère favorable à l’idée de coloniser l’Algérie en y transplantant des métropolitains. Il rêve plutôt d’un grand « royaume arabe » avec lequel notre pays serait allié et propose pour cela de hâter la naturalisation française d’une nombreuse élite locale. Les fonctionnaires coloniaux veillent, les ordres de l’empereur ne seront pas appliqués. Sitôt la chute du régime, les choses reprennent comme avant. En 1871, nous explique encore La République coloniale, le Parlement prévoit de donner aux colons d’Algérie 100 000 hectares de terres. Il ne dit pas un mot des gens qui y vivaient jusqu’alors, sauf pour mentionner les punitions prévues pour ceux qui résisteraient aux spoliations.
Il faut un demi-siècle encore et des circonstances particulières pour que l’image des colonisés évolue un peu. Pendant la guerre de 1914 on a besoin d’hommes. Le général Mangin a l’idée de « la force noire », ces puissants soldats des colonies qui vont sauver la métropole. En Afrique (et aussi en Indochine), on recrute à tour de bras, souvent en employant la force, d’ailleurs. Grâce au courage dont ils font preuve dans les tranchées, la représentation des dominés changent : le « sauvage » d’hier devient le brave tirailleur naïf mais robuste, le fameux « y a bon banania ! ». Pour autant la ségrégation est toujours là : sur 30 000 Algériens aux armées, on compte 250 officiers. Et quand Paris tente des réformes, comme au moment du Front populaire, qui prévoit d’élargir le droit de vote à quelques milliers d’autochtones, elles sont à nouveau systématiquement torpillées par les colons : ils ne veulent rien perdre de leurs petits privilèges ni de leur immense supériorité. Après la Seconde Guerre mondiale et la lutte contre le nazisme, un vent d’émancipation souffle sur le monde. Quelques-uns des excès les plus criants du système sont enfin supprimés, comme le travail forcé ou le Code de l’indigénat. La citoyenneté de plein droit n’arrive toujours pas. En Algérie, jusqu’en 1958, on vote selon un « double collège » qui dénote une conception très particulière de l’équité électorale : la voix d’un « Français » vaut celle de 7 « musulmans ». Tout un symbole.
François Reynaert. Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises. L’histoire de France sans les clichés. Fayard, 2010.
Notes
1 À ceux qui veulent en savoir plus sur la colonisation sous ses divers aspects, on conseillera deux livres : le Dictionnaire de la France coloniale (Flammarion, 2007), très riche, très clair, et faisant la part à toutes les thèses sans exclusive. Et, à propos de l’incroyable dépeçage de tout le continent noir, l’ouvrage savoureux et remarquable du Néerlandais Henk Wesseling, Le Partage de l’Afrique (« Folio », Gallimard, 2002).
2 Voyage au Congo, Gallimard, 1927.
3 Coécrit par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Françoise Vergès, Hachette littératures, 2006.